Longtemps effacée des récits classiques, l’Afrique fut pourtant actrice de l’Antiquité gréco-romaine : rois éthiopiens, reines nubiennes, penseurs égyptiens, soldats noirs, citoyens romains. Ce grand récit, entre silences organisés et mémoire retrouvée, révèle une Antiquité plurielle. Et si, derrière le marbre blanc de Rome, se cachait une histoire tissée d’ombre, d’or et d’ébène ?
Les visages noirs de l’Antiquité
L’Afrique aux origines du monde classique

Dans l’imaginaire occidental, le berceau de la civilisation occidentale est double : Athènes pour la pensée, Rome pour la puissance. Cette vision, polie par des siècles de récit colonial et eurocentré, relègue souvent l’Afrique au hors-champ de l’Histoire. Pourtant, à bien y regarder, l’Afrique fut non seulement présente, mais centrale dans le regard et la formation même de l’univers gréco-romain.
Il est une vérité que l’histoire académique occidentale a longtemps refoulée, ou travestie : la Grèce classique s’est nourrie à la table de l’Afrique.
L’Égypte, aux yeux des anciens Grecs, n’était pas un mystère exotique ou une terre à conquérir. Elle était un sanctuaire du savoir, un lieu ancien où la sagesse semblait sédimentée dans les pierres, les temples, les fleuves. Bien avant que l’Europe ne s’arroge le monopole de la raison, les rives du Nil étaient considérées comme une école antique de philosophie, de science et de spiritualité.
Hérodote, dans ses Histoires, ne laisse guère de doute : pour lui, les Égyptiens ont inventé l’écriture, les mathématiques, les principes médicaux, et transmis aux Grecs une part de ce trésor intellectuel.
Manifestement, en effet, les Colchidiens sont de race égyptienne ; mais des Egyptiens me dirent qu’à leur avis les Colchidiens descendaient des soldats de Sésostris. Je l’avais conjecturé moi-même d’après deux indices : d’abord parce qu’ils ont la peau noire et les cheveux crépus , ensuite et avec plus d’autorité, pour la raison que, seuls parmi les hommes, les Colchidiens, les Egyptiens et les Ethiopiens pratiquent la circoncision depuis l’origine.
Les Phéniciens et les Syriens de Palestine reconnaissent eux-mêmes qu’ils ont appris cet usage des Egyptiens. Les Syriens, qui habitent la région du fleuve Hermodon et du Pathenios, et les Macrons, qui sont leurs voisins, disent l’avoir appris récemment des Colchidiens. Ce sont là les seuls hommes qui pratiquent la circoncision et l’on peut constater qu’ils le font de la même manière que les Egyptiens.
Des Egyptiens eux-mêmes et des Ethiopiens, je ne saurais dire lesquels des deux apprirent cette pratique des autres ; car c’est évidemment chez eux une chose très ancienne ; qu’on l’ait apprise en fréquentant l’Egypte, voici qui en est aussi pour moi une forte preuve : tous ceux des Phéniciens qui fréquentent la Grèce cessent de traiter les parties naturelles à l’imitation des Egyptiens et ne soumettent pas leurs descendants à la circoncisionHérodote, Livre II, Chapitre 104
Ce jugement n’est pas isolé. De nombreux auteurs antiques (Strabon, Diodore de Sicile, Plutarque) répètent, parfois avec admiration, parfois avec perplexité, que les Grecs ont puisé à la source égyptienne.
Les Éthiopiens disent que les Égyptiens sont une de leurs colonies qui fut menée en Égypte par Osiris. Ils prétendent même que ce pays n’était au commencement du monde qu’une mer mais que le Nil, entraînant dans ses crues beaucoup de limon d’Éthiopie, l’avait enfin comblé et en avait fait une partie du continent.
Ils ajoutent que les Égyptiens tiennent d’eux, comme de leurs auteurs et de leurs ancêtres, la plus grande partie de leurs lois; c’est d’eux qu’ils ont appris à honorer les rois comme des dieux et à ensevelir leurs morts avec tant de pompe; la sculpture et l’écriture ont pris naissance chez les Éthiopiens.Diodore de Sicile, Livre 3
Des figures légendaires comme Homère, Orphée, Solon, ou Thalès de Milet sont décrites comme ayant voyagé en Égypte. Même Pythagore, dont le théorème est enseigné dans toutes les écoles d’Occident, aurait été initié dans les temples de Memphis ou d’Héliopolis, auprès des prêtres africains. Il y aurait appris non seulement les mathématiques, mais aussi la cosmologie, la réincarnation, et l’harmonie des sphères, idées centrales de son enseignement.
« C’est ce qu’attestent unanimement les plus sages d’entre les Grecs, Solon, Thalès, Platon, Eudoxe, Pythagore et suivant quelques-uns, Lycurgue lui-même, qui voyagèrent en Égypte et y conférèrent avec les prêtres du pays.
On dit qu’Eudoxe fut instruit par Conuphis de Memphis, Solon par Sonchis de saïs, Pythagore par Enuphis l’Héliopolitain.
Pythagore surtout, plein d’admiration pour ces prêtres, à qui il avait inspiré le même sentiment, imita leur langage énigmatique et mystérieux et enveloppa ses dogmes du voile de l’allégorie. La plupart de ces préceptes ne diffèrent point de ce qu’on appelle en Égypte des hiéroglyphes« Plutarque
Ce ne sont pas là que des mythes embellis. Le consensus archéologique et philologique établit aujourd’hui des flux de savoirs très concrets entre la vallée du Nil et la mer Égée, notamment à travers les grandes cités du Delta égyptien comme Naucratis, où cohabitaient Grecs et Égyptiens dès le VIIe siècle av. J.-C.
« Il est frappant que presque aucun nom de savant Egyptien n’ait survécu. Par contre, la quasi-totalité de leurs disciples Grecs sont passés à la postérité en s’attribuant les inventions et découvertes de leurs maîtres Egyptiens anonymes.
C’est ce qui ressort des passages de Jamblique qui précèdent, et des écrits d’Hérodote, faisant allusion à Pythagore qui se faisait passer pour l’inventeur des idées de ses maîtres. »Cheikh Anta Diop – Antériorité des Civilisations Nègres.
L’Afrique, dans sa forme égyptienne, n’est donc pas en dehors de l’Antiquité classique. Elle est fondatrice. Elle représente une matrice intellectuelle que les Grecs eux-mêmes ne niaient pas. Mais à mesure que l’Europe moderne s’est érigée en centre de la rationalité, ce passé a été déclassé, refoulé, parfois déraciné au profit d’un récit de pureté hellénique.
Il a fallu redécouvrir ces liens. Il a fallu relire Hérodote, fouiller Saqqarah, comparer les traités. Il a fallu des voix comme celles de Cheikh Anta Diop, pour rappeler que l’Afrique n’était pas une ombre, mais une lumière, celle qu’on a cachée.
“Les contemporains de la naissance de l’égyptologie moderne savaient parfaitement que l’Égypte était une civilisation nègre et négro-africaine, mais ils ont falsifié sciemment l’histoire.”Cheikh Anta Diop à la télévision française, sur la chaîne RFO 1983.
Ainsi, avant d’être une périphérie dans les manuels, l’Afrique fut un modèle pour les maîtres de la philosophie. Une école du monde que l’histoire a voulu oublier. Mais que la mémoire, elle, refuse d’abandonner.
Bien avant que l’Afrique ne soit peinte par les Européens comme une terre de ténèbres, de sauvagerie ou de retard, elle fut pour les Grecs anciens un repère moral, presque un idéal philosophique.
Dans la littérature classique, les Éthiopiens occupent une place étonnante. Le mot grec Aithiopes, littéralement « visage brûlé », désignait les peuples situés au sud de l’Égypte, au-delà du monde connu, mais pas au-delà du respect. Bien au contraire. Chez Homère, ils sont évoqués avec admiration. Dans l’Iliade, les dieux de l’Olympe quittent leur trône céleste pour aller festoyer avec eux. Ce simple passage est d’une puissance symbolique immense : il n’y a pas de hiérarchie divine qui les relègue, il y a une communion, un banquet sacré où l’on mange, discute et rit… avec des Noirs.
Homère écrit que les Éthiopiens sont « les plus justes des hommes« . Voilà une évaluation morale, pas une classification biologique. Dans l’imaginaire grec archaïque, l’Éthiopie n’est pas un territoire de crainte ou de conquête. C’est une terre d’équilibre, où les hommes vivent selon des lois respectées même par les dieux.
On est loin des visions ultérieures, où les peuples noirs seront associés à la bestialité, à l’irrationalité, à l’altérité absolue. Ici, dans l’aube de la pensée occidentale, l’Afrique est modèle de vertu. Une source non seulement géographique, mais spirituelle.
Ce regard est ancien, nuancé, complexe. Car chez les Grecs, l’altérité se joue sur plusieurs niveaux : les mœurs, les coutumes, la langue, le comportement. La couleur de peau, si elle est observée, n’est pas encore le socle d’une hiérarchie systémique. Elle est une caractéristique parmi d’autres, pas un marqueur de valeur.
Ce n’est pas pour autant une vision « égalitaire » au sens moderne. Il ne faut pas projeter nos idéaux contemporains dans l’Antiquité. Mais il faut reconnaître que le racisme fondé sur la biologie (celui qui triomphera avec la traite transatlantique et la colonisation) n’était pas encore né. Les préjugés existaient, certes, mais la peau noire n’était pas, en soi, synonyme d’infériorité.
Et c’est cela qui fait de cette époque un carrefour essentiel à redécouvrir. Car si les Grecs ont pu concevoir une humanité multiple sans l’ordonner en races fixes, c’est que d’autres formes de relation au monde étaient possibles. D’autres cosmologies. D’autres futurs.
Il nous revient, aujourd’hui, d’en réactiver la mémoire. Non pour mythifier le passé, mais pour démonter les mythes modernes qui ont recouvert l’histoire de silence et de blanchiment.
De l’Éthiopie mythique au Kemet historique, l’Afrique n’est pas à la marge de l’histoire gréco-romaine. Elle est son fond de scène, son matériau originel, parfois même son horizon sacré.
Mémnon, héros noir de la guerre de Troie

Il y a dans le panthéon de la mémoire européenne un absent dont la silhouette réapparaît, ombrée d’or et d’oubli : Mémnon, roi d’Éthiopie, fils de l’Aurore et de Tithonos. Un héros noir, célébré par les Anciens, effacé par les Modernes.
Mémnon n’est pas un héros de l’Iliade stricto sensu. Il surgit dans les épopées dites « cycliques », postérieures, parfois reléguées dans la marge du canon homérique. Mais son importance n’en est pas moindre : il est celui qui ose affronter Achille — et presque le vaincre. Il tue Antiloque, brave le demi-dieu, et dans un combat d’une intensité quasi-cosmique, il tombe. Mais pas comme un vaincu. Il meurt dans la splendeur. Et Zeus lui accorde l’immortalité, un honneur rare, réservé aux élus.
Cette apothéose n’est pas un détail. Dans une culture où l’immortalité est la marque du divin ou du juste, ce geste de Zeus consacre Mémnon non seulement comme un héros tragique, mais comme un équivalent d’Achille.
Et pourtant, ce n’est que dans la littérature hellénistique (plusieurs siècles après la rédaction des textes homériques) que sa couleur de peau devient un attribut central. Agatharchide de Cnide, Théodore de Sicile, et d’autres auteurs tardifs, précisent : Mémnon était un roi éthiopien, un Noir, un fils du continent africain. Son royaume serait situé au-delà de la Haute-Égypte, dans ce que les Grecs appelaient Aithiopia, ce vaste Sud noir encore indéfini dans la géographie antique.
Mémnon, donc, est noir. Et il n’est ni esclave, ni serviteur, ni objet exotique. Il est roi, guerrier, héros, presque demi-dieu. Dans une tradition qui valorise la bravoure, l’honneur, la filiation divine, sa place est incontestable.
Ce que ce cas révèle, c’est un glissement mémoriel. À mesure que l’Europe s’éloigne de ses racines méditerranéennes, qu’elle construit ses empires coloniaux, elle réécrit son passé. Les héros noirs deviennent gênants. Les références africaines sont reclassées comme marginales. Mémnon, qui fut célébré, est oublié.
Son nom disparaît des versions scolaires des récits troyens. Les adaptations modernes (qu’elles soient littéraires, cinématographiques ou pédagogiques) le passent sous silence. Pourquoi ? Parce que la vision du monde a changé. Parce que le XIXe siècle a besoin d’un monde hiérarchisé, racialisé, avec une Antiquité blanche et une Afrique silencieuse.
Là où Homère et ses héritiers voyaient un guerrier royal africain, Gobineau, Renan ou Vacher de Lapouge (théoriciens de la race blanche supérieure) ne pouvaient tolérer qu’un héros noir figure dans la matrice culturelle de l’Europe.
Le retour de Mémnon dans les recherches contemporaines n’est pas une anecdote académique. C’est un acte de réparation intellectuelle. C’est affirmer que l’imaginaire grec était plus vaste que ce que l’Occident moderne a voulu croire. C’est dire que les représentations anciennes admettaient des figures noires puissantes, admirables, complexes.
L’historien Frank M. Snowden, dans ses travaux sur les Noirs dans l’Antiquité, a toujours insisté : le racisme, tel que nous le connaissons, n’était pas constitutif du monde gréco-romain. Il y avait des préjugés, des moqueries, des hiérarchies, mais pas de théorie de l’infériorité raciale adossée à la biologie.
Ainsi, la présence de Mémnon ne choquait pas les anciens. Elle ne devint problématique qu’avec la modernité raciste.
Mémnon est donc une clé mémorielle. Il est ce qui aurait pu être : une Antiquité plurielle, une Europe consciente de ses racines africaines, un imaginaire sans exclusion.
Le fait même qu’il faille aujourd’hui rétablir sa figure est révélateur : l’oubli n’est jamais neutre. Il est construction, il est pouvoir.
Réhabiliter Mémnon, c’est briser un pan du mythe d’une Antiquité blanche, et rappeler qu’à Troie, déjà, les héros pouvaient être noirs, africains, et glorieux.
Les Africains dans Rome
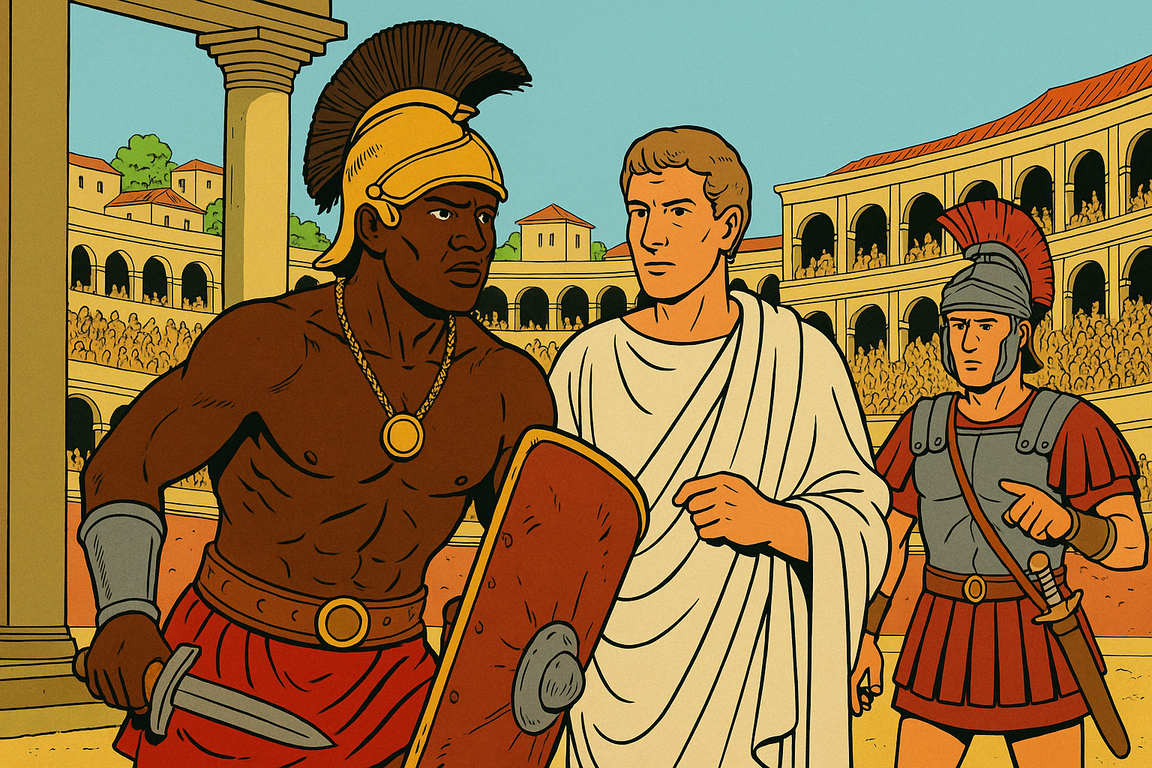
Dans l’imaginaire collectif contemporain, les Africains dans la Rome antique sont le plus souvent relégués à des images figées : esclaves silencieux dans les villas patriciennes, curiosités exotiques dans les fresques pompéiennes, silhouettes anonymes dans les arènes. Mais ce regard est un reflet, non pas de l’Antiquité elle-même, mais des prismes à travers lesquels l’Europe moderne a relu cette Antiquité.
L’idée d’une Rome « blanche », ethniquement pure, est une fiction. L’Empire romain était un monde de migrations, de brassages, de conquêtes, et donc, d’hybridations. Rome n’était pas un village isolé sur les bords du Tibre. C’était une capitale impériale, un carrefour d’influences, où se croisaient Syriens, Ibères, Celtes, Égyptiens, Nubiens, Grecs, Juifs, et, bien entendu, Africains subsahariens.
Ces Africains, souvent désignés comme Aethiopes dans les textes latins, étaient visibles dans la ville : dans les marchés, dans les spectacles, dans l’armée, dans la domesticité. Loin d’être absents, ils étaient intégrés, parfois marginalisés, mais toujours présents.
Le travail rigoureux de l’historien Frank M. Snowden, appuyé par une iconographie abondante et des sources littéraires précises, a mis en évidence une réalité souvent occultée : la couleur de peau n’était pas, à Rome, un critère de statut ou d’essentialisation raciale.
Il est donc possible (et documenté) d’être noir et libre, blanc et esclave, ou noir et citoyen.
L’esclavage romain était fondé sur des facteurs militaires, économiques et juridiques. On devenait esclave parce qu’on avait perdu une guerre, parce qu’on était né de parents esclaves, ou parce qu’on avait été vendu. Cela concernait aussi bien les Gaulois que les Numides, les Daces que les Éthiopiens.
Et surtout, l’affranchissement était fréquent. L’institution du libertus permettait à un ancien esclave d’accéder à la liberté, et souvent à la citoyenneté romaine. Certains affranchis enrichis devinrent mécènes, architectes, commerçants, voire prêtres de cultes officiels.
Dans le monde du spectacle, les Africains occupaient une place paradoxale. Ils étaient à la fois exhibés pour leur altérité, dans les arènes, dans les théâtres, dans les jeux, et valorisés pour leurs compétences.
- Gladiateurs noirs : représentés dans les mosaïques, parfois adulés comme des stars, ils étaient sélectionnés pour leur force et leur singularité. L’iconographie les montre parfois en posture victorieuse.
- Chanteurs, musiciens, acteurs : l’Afrique était aussi associée à des talents vocaux et scéniques. L’exotisme nourrissait l’attraction du public, sans effacer le respect artistique.
- Acrobates et danseurs : souvent issus de l’Afrique subsaharienne, ils se produisaient dans les banquets et les cirques, parfois dans les troupes itinérantes de l’Empire.
Dans l’armée, la présence africaine est plus sérieuse encore. Des Nubiens, des Maures, des Libyens combattent pour Rome, parfois en tant qu’auxiliaires, parfois dans les légions régulières. Le cas de Lucius Quietus, général maure sous Trajan, est emblématique. Il devient gouverneur de Judée, chef militaire écouté, preuve que la couleur de peau n’entravait pas l’ascension dans l’appareil impérial, du moment que l’allégeance à Rome était assurée.
Et que dire de Septime Sévère, empereur romain né à Leptis Magna, en actuelle Libye ? Son règne marque l’apogée d’un cosmopolitisme impérial où l’origine géographique, sinon la couleur, ne bloque pas l’accès au pouvoir suprême.
L’art romain abonde en représentations de Noirs. On les retrouve sur des mosaïques, des camées, des bas-reliefs, des statuettes en bronze. Ces figures sont souvent précises : traits négroïdes, peau foncée, chevelure crépue, morphologie spécifique.
Mais cette visibilité est ambivalente. Elle peut être hommage ou caricature, réalisme ou exotisation. Parfois honorée, parfois tournée en dérision, la figure du Noir est inclus sans égalité, mais sans systématisation raciale.
Rome regardait le monde avec supériorité, mais non selon les catégories racistes modernes. Elle dominait, mais ne naturalisait pas l’infériorité.
La question, in fine, est celle du silence. Pourquoi, dans la culture populaire contemporaine, ces figures ont-elles été effacées ?
Parce que la construction moderne de l’Antiquité (surtout au XIXe siècle) a blanchi Rome. Il fallait fabriquer une généalogie raciale de la civilisation, où l’Europe apparaîtrait comme l’héritière naturelle de la grandeur antique. Dans cette vision, les Noirs ne pouvaient être que des esclaves. Toute autre position devenait hérétique.
Réhabiliter la présence africaine dans Rome, c’est donc rétablir une vérité historique, mais aussi démanteler un mythe racial. C’est rappeler que les Noirs ne sont pas apparus dans l’histoire avec la traite transatlantique. Ils y étaient déjà, et parfois au cœur du pouvoir.
Koush contre Rome, l’exemple méroïtique

Dans les manuels d’histoire les plus classiques, la marche de Rome semble inéluctable, triomphale, écrasant tout sur son passage. De la Bretagne jusqu’à la Mésopotamie, l’empire s’est imposé, conquérant territoires, peuples et dieux. Pourtant, à la lisière sud de l’Égypte romaine, une puissance africaine, dirigée par une femme, a dit non, et Rome a reculé.
Cette puissance, c’est le royaume de Koush, plus précisément son incarnation de l’époque méroïtique. Situé dans l’actuel Soudan, au sud de la première cataracte du Nil, Koush était l’héritier de l’Égypte pharaonique, mais avec une culture propre : écriture méroïtique, art distinctif, architecture de pyramides, et une structure politique fortement centralisée.
Lorsque l’Égypte passe sous le contrôle romain après la défaite de Cléopâtre et de Marc Antoine à Actium en -31, Rome hérite d’un voisin stratégique qu’elle ne connaît que peu : Koush. Dès -25, les tensions éclatent. Profitant du redéploiement des troupes romaines, les armées koushites lancent une attaque éclair sur Syène (Assouan), pillent les villes de la région, s’emparent de prisonniers, et vont jusqu’à décapiter des statues de l’empereur Auguste.
Ce geste n’est pas qu’un acte militaire. C’est un message politique fort, une profanation symbolique. En s’en prenant à la représentation impériale, les Koushites affirment leur souveraineté et leur refus de la romanisation.
À la tête de cette offensive : Amanirenas, kandake du royaume, c’est-à-dire reine-mère et régente militaire. L’histoire nous dit peu de choses sur elle, sinon qu’elle était borgne (probablement blessée au combat) et qu’elle dirigeait personnellement les troupes. Son nom, gravé sur les stèles méroïtiques, résonne aujourd’hui comme celui d’une des rares femmes de l’histoire antique à avoir résisté militairement à Rome sans capituler.
Ce n’est pas une anecdote féministe tardive. C’est un fait historique lourd de sens. Tandis que Rome relègue les femmes au domaine privé, le royaume méroïtique place à sa tête une guerrière, cheffe d’État, négociatrice. Amanirenas est l’équivalent sud-nilique de Boudicca en Bretagne ou de Cléopâtre en Égypte, sauf qu’elle gagne.
Face à cette résistance, Rome contre-attaque. Le général Caius Petronius mène une expédition punitive, détruit Napata, ancienne capitale religieuse de Koush. Mais il ne parvient pas à briser la résistance koushite. Le conflit s’enlise, le coût devient disproportionné. Auguste, pragmatique, accepte la négociation.
Le traité signé vers -21, rapporté par le géographe grec Strabon, est tout simplement inédit dans l’histoire de Rome :
- Rome renonce à son projet d’extension vers le sud.
- Les troupes impériales se retirent jusqu’à Syène.
- Aucun tribut n’est imposé à Koush.
- La frontière est formellement reconnue, légitimant l’intégrité du royaume.
Ce traité n’est pas une faveur. C’est une victoire diplomatique méroïtique, obtenue non par flatterie ou soumission, mais par la guerre et la négociation. À l’inverse des autres peuples conquis, les Méroïtes arrachent leur respect par la force et la diplomatie.
Pourquoi cette séquence est-elle si peu connue ? Pourquoi Amanirenas n’est-elle pas enseignée aux côtés d’Hannibal ou de Vercingétorix ?
Peut-être parce qu’elle dérange. Parce qu’elle invalide le récit d’une Antiquité blanche, virile et victorieuse. Parce qu’elle montre une Afrique souveraine, organisée, et capable de faire plier l’empire le plus redouté de l’histoire.
Dans les représentations classiques de Rome, il n’y a pas de place pour les résistances noires victorieuses. Pas de fresques pour les kandakes. Pas de film. Pas de panthéon.
Et pourtant, les archives sont là. Strabon l’écrit. Les temples de Méroé l’affichent. Les stèles le rappellent. Le passé ne ment pas. Il suffit de le lire.
Mémoires fragmentées, histoires à reconstruire

Il existe une étrange amnésie au cœur du récit occidental de l’Antiquité. Une cécité soigneusement cultivée. Dans les manuels scolaires, les musées d’art classique, les fictions historiques, l’Afrique apparaît rarement, et si elle apparaît, c’est souvent comme une marge silencieuse, un décor d’exotisme.
Pourtant, l’Afrique antique n’était ni muette, ni marginale. Elle était actrice, interlocutrice, parfois même inspiratrice du monde gréco-romain.
Alors pourquoi l’a-t-on oubliée ?
Pendant longtemps, les Grecs et les Romains ont reconnu la diversité humaine sans nécessairement la hiérarchiser selon la couleur. Les Éthiopiens, les Égyptiens, les Numides étaient des peuples parmi d’autres, parfois ennemis, parfois alliés, mais toujours considérés dans leur complexité.
Ce n’est qu’avec l’avènement du colonialisme européen, entre le XVe et le XIXe siècle, que l’idée de « race » va s’imposer comme grille de lecture unique. Cette grille, rétroactivement appliquée à l’Antiquité, va blanchir Rome et la Grèce, tout en noircissant l’Afrique d’ignorance et de barbarie.
Dans ce révisionnisme inversé, les Africains de l’Antiquité sont soit gommés, soit reclassés comme exceptions insolites, jamais représentatifs.
Ce processus n’est pas qu’un oubli passif. Il relève d’une stratégie plus large : celle de l’effacement de la puissance noire dans le récit de la civilisation. En excluant l’Afrique des généalogies gréco-romaines, l’Europe moderne justifie l’esclavage, la colonisation, la mise sous tutelle.
Redonner à l’Afrique sa place dans l’histoire antique, ce n’est donc pas seulement un acte de recherche. C’est un acte de réparation.
C’est dire : vous étiez là. Vous faisiez partie du monde. Vous avez contribué à la culture classique, pas en marge, mais au cœur.
Depuis les années 1970, des chercheurs africains, afrodescendants et alliés critiques, ont entrepris de reconstruire cette mémoire fragmentée. Des historiens comme Cheikh Anta Diop, Frank Snowden, Runoko Rashidi, Mario Beatty, ont mis en lumière la présence noire dans l’Antiquité avec des méthodes rigoureuses, des archives croisées, et une exigence de vérité.
Leurs travaux ont redonné vie à Mémnon, à Amanirenas, aux soldats noirs de l’armée romaine, aux philosophes égyptiens dans les écoles d’Alexandrie. Et à travers eux, c’est tout un pan du monde gréco-romain qui retrouve ses couleurs d’origine — multiples, bigarrées, vivantes.
Mais ce travail est encore fragile. Car l’histoire, on le sait, n’est pas seulement écrite avec des plumes. Elle l’est aussi avec des institutions. Et tant que ces récits ne seront pas intégrés dans les cursus, dans les musées, dans les narrations dominantes, ils resteront en marge.
Pour une relecture radicale de l’Antiquité
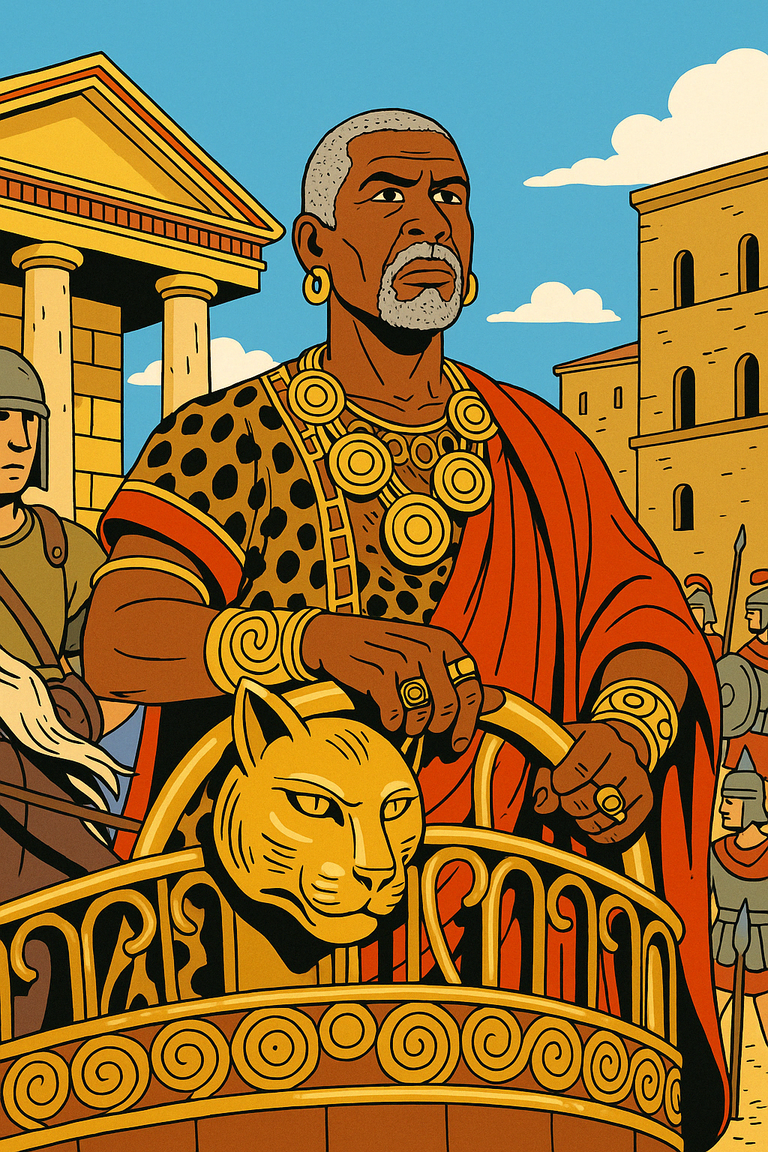
Réécrire l’histoire, ce n’est pas travestir la vérité. C’est redresser ce que d’autres ont déformé.
Car l’idée d’une Antiquité blanche, rigide, fondatrice d’un Occident homogène n’est pas le fruit d’Homère, ni de Plutarque. Elle n’est pas née dans les temples du Parthénon ou sous les voûtes du Panthéon. Elle a été fabriquée, au scalpel et à l’encre raciale, dans les bibliothèques impériales de l’Europe du XIXe siècle.
Cette Antiquité blanchie, aseptisée, est une invention politique. Elle a servi à justifier la colonisation, à légitimer l’esclavage, à construire un récit historique où l’Europe serait l’héritière unique de la civilisation, et l’Afrique, son contraire organique.
Mais l’Antiquité réelle, celle des sources, des fouilles, des voix étouffées, est plurielle. Elle est noire, métissée, marchande, itinérante. Elle est tissée de rencontres, de conflits, d’échanges, de fusions.
La réaction au casting de Denzel Washington dans Gladiator II dit beaucoup plus de nous que de l’Histoire. Cette présence choque, non par incohérence historique, mais parce qu’elle brise un mythe. Celui d’une Rome ethniquement pure, blanche de peau, grecque de sang, européenne d’âme.
Et pourtant : les Noirs ont bel et bien vécu à Rome. Ils y ont servi comme soldats, exercé comme commerçants, dansé comme artistes, combattu comme gladiateurs. Certains furent esclaves, oui, mais d’autres furent libres, affranchis, même puissants. L’Empire romain, dans son immense diversité, intégrait sans fonder l’ordre social sur la race biologique.
Denzel dans l’arène n’est pas une relecture contemporaine. C’est une restitution d’une réalité refoulée. C’est remettre un corps noir là où il a été effacé par deux siècles de productions visuelles européocentrées.
Réintégrer l’Afrique dans le récit gréco-romain n’est pas un geste identitaire. C’est une nécessité pédagogique.
Tant que les enfants d’origine africaine ne verront pas dans l’Antiquité autre chose que des figures serviles ou exotiques, ils seront exclus, par omission, du cœur de la culture dite « classique ». Tant que les Noirs ne seront visibles que dans l’esclavage moderne, leur histoire semblera commencer avec leur asservissement.
Et cela a des effets concrets : sur l’estime de soi, sur les imaginaires collectifs, sur la légitimité ressentie à étudier les lettres, la philosophie, la politique.
Une relecture radicale de l’Antiquité, qui inclut Mémnon, Amanirenas, Septime Sévère ou les penseurs d’Alexandrie, est une relecture inclusive. Elle ne nie pas l’Europe. Elle la complexifie, en montrant que l’universel n’est pas le monopole de l’Occident, mais le fruit de circulations anciennes.
Donner à l’Afrique sa place dans le récit antique, ce n’est pas simplement reconnaître le passé. C’est réarmer symboliquement l’avenir.
C’est rappeler que l’histoire noire ne commence pas dans les cales des navires négriers, mais dans les temples de Kemet, les murailles de Méroé, les bibliothèques de Carthage. C’est rappeler que les Africains ont philosophé, gouverné, construit, inventé, bien avant d’être colonisés.
C’est aussi interroger ce que l’on appelle « l’universel ». Car si l’universel ne reflète que les visages blancs de la mémoire européenne, alors il n’est qu’un particulier qui se croit central.
Un universel véritable ne peut naître que lorsque chaque peuple peut y voir son reflet, y inscrire ses noms, ses morts, ses dieux, ses héros.
Ce que nous appelons aujourd’hui Rome ou la Grèce antique ne furent jamais des civilisations repliées sur elles-mêmes. Elles furent des carrefours, des creusets, des lieux de synthèse.
Ce que nous appelons Afrique, ce que l’on a tenté d’écarter du récit classique, était en réalité présente, agissante, familière, bien plus que l’histoire officielle ne le dit.
Réécrire l’Antiquité à la lumière de cette vérité, c’est détricoter les fictions coloniales, redonner voix aux silences, et ressusciter les présences invisibles.
C’est faire de l’Histoire (pas un mur) mais un miroir.
Notes et références générales
- Hérodote, Histoires, Livre II, trad. A. Barguet, GF Flammarion, 1995.
- Martin Bernal, Black Athena : The Afroasiatic Roots of Classical Civilization, Rutgers University Press, vol. I–III, 1987–2006.
- Cheikh Anta Diop, Nations nègres et culture, Présence Africaine, 1954.
- Quintus de Smyrne, Suite d’Homère, trad. P. Waltz, CUF, 1940.
- Agatharchide de Cnide, De l’Erythrée, fragments dans Diodore de Sicile, Livre III.
- Frank M. Snowden Jr., Blacks in Antiquity: Ethiopians in the Greco-Roman Experience, Harvard University Press, 1970.
- Runoko Rashidi, African Star over Asia: The Black Presence in the East, Books of Africa, 2012.
- Frank M. Snowden Jr., Before Color Prejudice: The Ancient View of Blacks, Harvard University Press, 1983.
- Shelley Haley, “Be Not Afraid of the Dark: Critical Race Theory and Classical Studies,” Classical World, Vol. 106, No. 2, 2013.
- Duane W. Roller, The World of Juba II and Kleopatra Selene, Routledge, 2003.
- A. D. H. Bivar, “The Africans in Roman Britain,” Antiquity, 43(171), 1969.
- Strabon, Géographie, Livre XVII, trad. F. Lasserre, CUF, 1975.
- Derek A. Welsby, The Kingdom of Kush: The Napatan and Meroitic Empires, Markus Wiener Publishers, 1996.
- Shinnie, P.L., Ancient Nubia, Methuen, 1978.
- D.T. Niane (dir.), Histoire générale de l’Afrique, UNESCO, Vol. II, 1984.
- Michel-Rolph Trouillot, Silencing the Past: Power and the Production of History, Beacon Press, 1995.
- Mary Lefkowitz & Guy MacLean Rogers (dir.), Black Athena Revisited, University of North Carolina Press, 1996.
- Mario Beatty, “Africa and the Classical World,” The Journal of Pan African Studies, Vol. 7, No. 1, 2014.
- Paulin Hountondji, Sur la « philosophie africaine », Maspero, 1976.
- Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage, Afrique et Grèce : L’héritage invisible, Note thématique, 2023.
- Mary Beard, SPQR: A History of Ancient Rome, Liveright, 2015.
- Dan-el Padilla Peralta, “Undocumented,” The New York Times Magazine, January 2016.
- Saidiya Hartman, Lose Your Mother: A Journey Along the Atlantic Slave Route, Farrar, Straus and Giroux, 2007.
- Ahmed Baba Institute (Timbuktu), archives manuscrites sur l’Afrique précoloniale.
