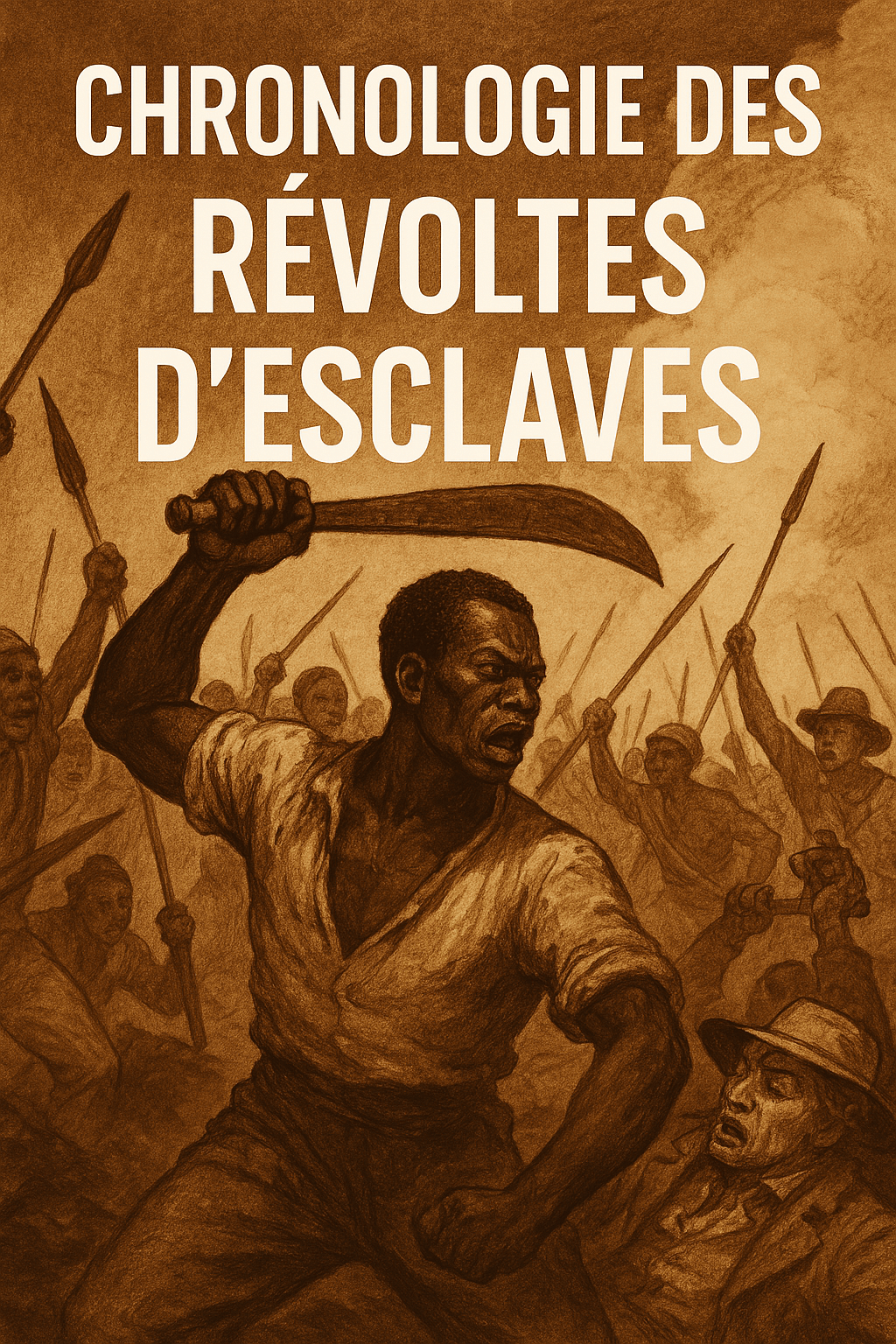Dans cette troisième partie de notre exploration des survivances africaines dans la culture antillaise, nous plongeons au cœur des pratiques et coutumes qui marquent les grands moments de la vie. Inspiré par l’essai “Survivances africaines” de Huguette Bellemare, publié dans Historial antillais. Tome I. Guadeloupe et Martinique. Des îles aux hommes (1981), cet article examine comment l’héritage africain continue de teinter les rites liés à la naissance, la première communion et la mort aux Antilles. À travers cette analyse, nous découvrons comment ces traditions se sont adaptées et ont persisté dans le contexte antillais, formant ainsi une culture unique et profondément enracinée dans l’histoire africaine.
De nombreux rites marquent les grands moments de la vie. Là encore, la discussion pour savoir d’ou ils sont originaires est très âpre. Cependant, dans ce domaine, les apports des deux cultures paysannes traditionnelles – africaine et européenne – n’ont pu que s’ajouter pour constituer la culture rurale traditionnelle des Antilles. Nous allons cependant essayer de montrer ce que nous croyons devoir tout particulièrement à l’Afrique dans ce domaine – ou encore plus simplement, la « coloration africaine » de certaines coutumes.
La naissance

Certaines croyances et pratiques qui entourent la naissance ont leur source en Afrique. En particulier, celles relatives aux arbres : elles sont basées sur un raisonnement analogique très clair.
Une femme enceinte peut communiquer sa fécondité aux arbres fruitiers en les plantant ou, s’ils sont déjà plantés, en les ferrant (en y enfonçant un clou).
Une femme enceinte ou allaitant ne doit pas couper un arbre fruitier.
Le placenta et le nombril d’un nouveau né peuvent être enterrés au pied d’un arbre qui lui communiquera sa vigueur et sa longévité.
Mais la grande affaire, aux Antilles comme en Afrique, c’est le nom.
En Afrique Occidentale, il est de coutume de donner aux enfants des noms liés à leur date de naissance (on leur donne parfois le nom du jour de leur naissance), aux conditions qui ont entouré cette naissance, au caractère ou à l’aspect de l’enfant.
Dans la Martinique rurale, cette coutume s’est maintenue dans la mesure où l’a permis le contrôle des autorités de l’État-civil.
En effet, on a longtemps appelé le premier enfant : Mon premier ou Alfa, le dernier (ou celui qu’on souhaite le dernier) Ultima ou Cétou ; l’enfant particulièrement désiré Mongré ou… Désiré(e), tout simplement ! On appelle Chimène celui qui est né sur le chemin. Les enfants portent souvent le nom du Saint du jour de leur naissance, d’où la confusion qui explique certains prénoms : Fêt-nat pour un enfant né le 14 juillet ou Circoncis pour un né le 1er Janvier, Gloria pour celui né le samedi de la semaine sainte…
« (En Afrique) l’identification d’un nom « réel » avec la personnalité de celui qui le porte est tenue pour si totale que ce nom « réel », habituellement donné à la naissance par un parent (mais) non par n’importe lequel, doit être gardé secret de peur qu’il ne vienne à être connu d’une personne susceptible de l’utiliser dans des pratiques magiques malfaisantes dirigées contre le porteur du nom ». Melville Herskovits, L’héritage du Noir, Mythe et réalité, Présence Africaine, Paris, 1962.
En Martinique, on ne prononce pas le prénom de quelqu’un de peur que les puissances du mal ne s’en emparent. D’ailleurs, prononcer le nom de quelqu’un, c’est déjà s’octroyer un certain pouvoir sur cette personne ainsi que le montre ce dialogue extrait d’un roman antillais :
– « Emmanuel, Joseph, Maurice, tu es malin comme un rat… tu vas voir ce qui va t’arriver !
– Tonnerre de Dieu, est-ce toi qui m’as porté au baptême pour répéter mes prénoms à chaque instant ?1. Ceci nous amène à penser que s’il y a tant de surnoms en Martinique, c’est pour tenir secret le véritable prénom2. Nous avons eu nous-même une proche parente de notre génération dont le prénom fut tenu caché jusqu’à son adolescence. Il nous est arrive également de demander à une paysanne le prénom de son bébé et de nous entendre répondre : « Ipas ni non » ce qui se traduit textuellement par « il n’a pas de nom », mais qui signifie en réalité que l’enfant n’étant pas encore baptisé, on ne prononce pas son prénom de peur que le Diable ne s’en empare.
La croyance que le nom d’un individu participe de sa personnalité et de sa puissance explique qu’on donne parfois pour prénom à des enfants le nom de personnages prestigieux dont on admire la puissance. Ainsi peut-on trouver dans les campagnes antillaises (comme en Afrique) des enfants se prénommant : De Gaulle, Staline ou Napoléon…
De nombreuses coutumes concernant la naissance ou la petite enfance se retrouvent aux Antilles et en Afrique.
En Martinique, comme en Afrique, on fait le tour de la maison avec le bébé quelques jours après la naissance, pour lui présenter les lieux où il va vivre.
En Afrique et chez les Noirs des USA, on « vend » un enfant de chétive santé pour éloigner de lui le mauvais sort et le sauver. En Martinique, dans la même situation, on « consacre » l’enfant à la Vierge ou à un Saint dont il portera la couleur (à l’exclusion de toute autre). Ici, la coutume africaine s’est peut-être « coulée dans un moule chrétien » pour survivre.
En Afrique et aux USA, lorsqu’un enfant tarde à marcher, on l’enterre nu jusqu’à la ceinture ; en Martinique, on l’enterre dans du sable s’il a les jambes cambrées…
La première communion

Ce titre peut sembler étonnant dans une étude consacrée aux « survivances africaines » dans les cultures antillaises. Cependant on peut dire de la première communion ce que Bastide a dit des grandes fêtes catholiques : les Noirs l’ont acceptée comme une « niche secrète pour y célébrer leurs fêtes ».
En effet, la première communion aux Antilles catholiques est l’occasion d’un faste et, plus concrètement, de dépenses extraordinaires. Les communiants -les jeunes filles surtout- rivalisent d’élégance et de beauté ; enfin, cette fête est l’occasion de véritables bombances où la parenté la plus éloignée, et même les plus simples voisins, sont conviés.
Cet aspect profane de la fête se développait à tel point que les autorités religieuses ont dû intervenir pour limiter tout particulièrement le luxe, parfois tapageur, des toilettes…
Pourquoi cette importance donnée à ce sacrement ?
C’est que la première communion « remplace les anciens rites de puberté des esclaves et des sauvages » (E. Revert) interdits par la colonisation et l’esclavage, ces rites qui marquent « l’accession à la plénitude de l’être, l’entrée dans la société » (J. Corzani).
Pour la jeune fille des milieux défavorisés surtout, qui a fort peu de chance de se marier à l’Église, le sacrement de première communion prend une importance particulière comme rite de passage et d’initiation.
Mayotte Capécia illustre tout cela fort bien dans son roman : Je suis Martiniquaise.
« Enfin, ma mère ouvrit la porte. Je poussai un cri de surprise. Ma chambre qui, jusque là avait été semblable à une chambre de garçon, était devenue une chambre de jeune fille. Le lit avait été recouvert d’une belle étoffe et, dans un coin, je vis une étagère sur laquelle se tenait une statue de la Vierge avec, devant elle, une veilleuse à huile que je devais, je le savais, entretenir afin qu’elle restât allumée nuit et jour.
C’était un autel comme celui qui se trouvait dans la chambre de mes parents, comme ceux que possédaient toutes les personnes raisonnables ».
La première communion permet donc le passage de la petite fille à la fois dans le monde des adultes et celui des femmes.
Un autre roman, le Temps des Madras, confirme encore cette interprétation cette fois sur le mode comique :
« Elle n’a pas fait sa première communion et elle chante la romance ! C’est la fin du monde ! »
Mais cette réinterprétation païenne de la première communion est-elle si éloignée de sa signification catholique ? Si les esclaves ont pu assimiler rites d’initiation et première communion, c’est qu’ils présentaient des similitudes remarquables (âge des intéressés -entre 9 et 12 ans-, retraite, jeûne dans les deux cérémonies…). Nous voyons donc ici un des cas (signalés par Herskovits) où des similitudes entre deux éléments de deux cultures permettent le renforcement de ces éléments.
La mort

Les croyances et coutumes au sujet de la mort sont extrêmement nombreuses aux Antilles et -encore une fois- il est difficile de démêler dans ce foisonnement la part qui revient à chacune des cultures rurales qui ont participé à la formation de la culture antillaise (culture européenne, culture africaine et –à moindre degré – culture amérindienne).
Comme nous avons procédé pour la naissance, nous essayerons donc de dégager les idées principales autour desquelles s’organisent les pratiques africaines et antillaises de la mort : la mort est le moment le plus important de la vie, c’est pour cela qu’elle doit être entourée de faste préparés longtemps à l’avance. Cependant, elle n’est pas irréversible, d’où une grande familiarité avec la mort, mais aussi un risque : le mort peut refuser de s’en aller ou saisir la moindre occasion de revenir, aussi faut-il tâcher de l’amadouer par toutes sortes d’attention.
Dans toutes les sociétés noires, les funérailles ont une grande importance… Aussi, les rites qui suivent la mort aux Antilles sont particulièrement
nombreux et particulièrement bien observés : en Martinique, par exemple, après la toilette du mort, celui-ci sera exposé dans ses vêtements les plus beaux. Ensuite, la mort est annoncée à la parenté et au voisinage. Autrefois, en l’absence de téléphone, l’annonce se faisait en soufflant de manière rituelle des « coups de corne » dans une conque de lambi.
Après la veillée, qui dure jusqu’à l’aurore3, c’est l’enterrement qui rassemble une foule de parents et d’amis, venus même de très loin, toute affaire cessante. Au cimetière après une oraison funèbre où est prononcé un véritable dithyrambe du mort, c’est l’inhumation. Lorsque la famille en a les moyens, elle possède un splendide caveau, mais même si elle n’a qu’une modeste fosse, celle-ci sera toujours pieusement entretenue.
La stricte observance de tous ces rites est tellement importante que tout sera fait, prévu, pour qu’ils soient respectés. Ainsi, l’oraison funèbre pourra être composée à l’avance, dès que le malade se trouve à l’agonie. Mais, qui mieux est, il est commun à la campagne que l’individu même prépare sa propre cérémonie funèbre : il se fera faire son cercueil à l’avance ou, en tous les cas, achètera et conservera les planches qui serviront à le confectionner, il achètera également une dame-jeanne de bon rhum et un paquet de café en grains pour sa veillée. Si c’est une femme, elle se fera confectionner, en plus, la robe dans laquelle elle veut être « exposée » et achètera le drap neuf qui doit lui servir de linceul.
Si la mort et les morts sont si proches, c’est que la mort n’est pas la fin de la vie, elle n’est qu’un passage ; les défunts vivent d’une autre vie et peuvent d’ailleurs intervenir – bénéfiquement ou maléfiquement4 – dans la vie de leurs descendants. C’est pourquoi il faut leur faire un enterrement convenable et les honorer (d’où le culte des ancêtres dont nous parlerons plus loin).
Mais cette proximité des morts, si elle a un effet bénéfique sur la communauté dont elle assure l’unité et la stabilité ne laisse pas d’être ambiguë : en effet, si les défunts continuent de vivre tout près de nous, ils peuvent revenir quand ils veulent dans le monde des vivants et ils peuvent, d’abord, refuser de le quitter à leur mort. D’où toute une série de pratiques qui ont pour but, à la mort, de faire partir l’esprit du défunt et ensuite de ne le laisser revenir qu’à certaines occasions, rituelles.
Par exemple, on met au mort des chaussettes neuves, encore attachées ensemble, dans le but, certainement de lui lier les pieds et de le faire tenir tranquille.
On lui met, sur la poitrine, une assiette contenant de l’eau bénite et une touffe de pied de poule (graminée) arrachée avec une énorme motte de terre dans le but avoué d’empêcher son ventre de gonfler, mais peut-être pour s’assurer de son immobilité.
Dans les mornes5, le corps devait être transporté à dos d’hommes, dans un brancard. Les porteurs bondissaient pour sortir de la maison mortuaire vraisemblablement pour vaincre la résistance du mort qui refuse de quitter les lieux où il a vécu.
Une fois le corps emmené, on lance à toutes volées l’eau qui avait servi à faire la toilette mortuaire et qui avait été conservée jusque là sous le lit d’exposition.
Le corps est donc transporté jusqu’au bourg voisin. Juste avant l’arrivée au bourg, sur le dernier pont, a lieu une extraordinaire cérémonie : Sous la direction du « conducteur du corps », les porteurs s’arrêtent puis font trois pas avant, trois pas en arrière et cela trois fois de suite avant de bondir encore une fois sur le corps. Cette danse du corps a certainement pour fonction de tromper le mort (de l’« égarer ») et de vaincre ses dernières résistances à s’en aller.
Enfin, une fois arrivés au bourg, les porteurs déposent le corps sur le « reposoir » puis, placé en face de lui, chacun fait le geste de s’étirer et, en se passant la main sur tout le corps, de lui rejeter la fatigue, les crampes contractées pendant le voyage. En réalité, il s’agit là, vraisemblablement, d’un rite de protection. On renvoie au mort les souillures attachées à son contact.
En effet, et c’est encore un des éléments de la signification ambiguë des soins dont on entoure les défunts, on croit communément à « une sorte de contagion de la mort » (Revert). À défaut de pouvoir rester parmi les vivants, le mort essaiera d’en entraîner avec lui. Son contact est donc dangereux -cela explique les facéties des porteurs qui essaient de se donner les uns les autres des « coups de corps », d’où la présence parmi eux du « conducteur de corps » qui les surveille, fouet en main. Enfin, au cimetière, lorsque l’inhumation a lieu dans une fosse, chacun doit jeter une motte de terre sur le cercueil, certainement dans le même but, empêcher le mort de venir l’emporter.
En effet, pendant huit jours, des prières sont dites autour du lit funèbre « sur lequel une petite lampe à huile reste allumée huit jours et huit nuits » (Revert). Le neuvième jour, est organisée dans la maison du mort une cérémonie analogue à la veillée mortuaire : les femmes autour du lit funèbre prient et chantent des cantiques, les hommes, dehors ou dans la salle (de séjour), boivent. Ensuite (à l’aube ?) on éteint la lampe, on défait le lit, on fait dire une messe à laquelle il est admis que le mort assiste (messe de sortie).
L’esprit du mort s’en va alors définitivement et ne reviendra plus qu’à des occasions bien précises, ses descendants peuvent donc reprendre leur vie de tous les jours, l’âme tranquille -si du moins toutes les prescriptions ont été correctement observées.
En effet, on pense généralement qu’un mort mécontent de ses héritiers ou des circonstances de sa mort peut revenir se venger. Aussi, on s’efforce d’exaucer les vœux qu’il a exprimés de son vivant. On fait dire des messes spéciales pour pacifier l’âme de ceux qui sont morts dans des circonstances atroces des suicidés, par exemple.
C’est certainement cette crainte de la vindicte du mort qui explique la pratique du charivari ou chalbari. Lorsqu’un veuf ou une veuve se remarie, la nouvelle est annoncée au son de la corne de lambi, et depuis la publication des bancs jusqu’au jour de son mariage, chaque soir, les gens de son quartier et des quartiers avoisinants se rassemblent autour de sa maison et ce sont des moqueries et un vacarme épouvantable réalisé à l’aide de morceaux de chaudrons et de métal. Le jour du mariage, ce même orchestre accompagne les époux à la mairie, à l’église puis chez eux.
« On a… perdu de vue, nous dit Revert, la valeur protectrice, à l’origine, de telles manifestations, pour n’y plus voir qu’une occasion de moquerie et d’amusement ». Revert, Magie Antillaise, p. 35. Pour la description de cette fête des morts qui est aussi fête de la vie, voir Diab’la de Zobel, pp. 140-150.
Aux Antilles, la Toussaint est un moment important du culte rendu aux morts. Elle est préparée longtemps à l’avance : on vient dans le cimetière nettoyer et repeindre les tombes, desherber les fosses, on demande aux enfants (contre rétribution) d’aller chercher du sable fin qu’on répandra sur les fosses, et de refaire les inscriptions effacées depuis l’année précédente. Puis le soir du 1er et du 2 novembre, c’est l’illumination : on allume des milliers et des milliers de bougies sur les tombes.
« Les familles sont là, près de leurs disparus. On vient leur serrer la main et s’entretenir un peu avec elles. C’est un défilé ininterrompu tandis qu’au dehors se déroule, mais singulièrement amplifiée, la même fête bruyante qu’aux veillées ». Revert, Magie Antillaise, p. 31.
Revert nous donne la signification de ces fêtes :
« Il est explicitement admis que les âmes des trépassés reçoivent, alors, la permission de revenir voir le décor terrestre et de passer quelques heures, de minuit à minuit, dans l’intimité des leurs ».
Certaines personnes illuminent également de bougies les alentours de leurs maisons pour permettre à « leurs » morts de retrouver le chemin des lieux où ils vécurent. Il est tellement admis que les morts vivent cette nuit-là et voient et apprécient ce qu’ont fait pour eux qu’ils se déroulent parfois de véritables batailles à l’entour de certaines fosses pour « s’approprier » l’esprit du mort ! Voir pour la description d’une de ces disputes le passage déjà cité de Diab’-là.
Une autre croyance populaire veut que les oiseaux nocturnes qui survolent alors le cimetière, sont les âmes des morts qui grâce aux soins des vivants (prières, illumination) quittent le purgatoire et regagnent le paradis.
Sommaire
Notes et références
- Fr. Ega, Le Temps des Madras. Lors d’une réunion publique, un brave homme s’indignait : « I titroyé moin ». « Il a clamé mon titre c’est-à-dire mon nom (de (famille) ! » ↩︎
- Le surnom c’est, en Martinique, le nom vante (du français vent) c’est-à-dire, vraisemblablement, le nom qui peut affronter la publicité sans dommage pour l’intéressé (au contraire du nom de baptême). ↩︎
- Voir la contribution d’Ina Césaire dans ce volume. ↩︎
- Ou malicieusement : Si vous ne vous occupez pas d’un de vos morts, il peut venir vous tirer les pieds ou vous toucher en vous laissant un « bleu » à l’endroit du contact. ↩︎
- Tous ces renseignements concernant les cérémonies funèbres dans les mornes m’ont été donnés par mon père qui passa sa jeunesse dans un de ces mornes, Rivière-Salée, où il a été lui-même témoin de ces pratiques et où il y a même participé. ↩︎